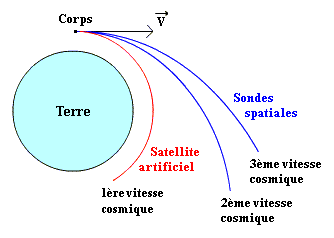Missions et voyages Terre - Mars, quelles conditions ?
I) Les conditions et les risques du voyage
Afin de quitter la Terre et de partir pour Mars, il faut que le vaisseau échappe à la force d’attraction terrestre. Pour voyager dans le système solaire il existe différentes vitesses appelées vitesses cosmiques.
La première vitesse cosmique (7.9 km/s) est la vitesse à atteindre pour pouvoir se placer en orbite autour de la terre.
La deuxième vitesse cosmique (11km/s) représente la vitesse limite permettant de s’évader définitivement de l’influence gravitationnelle de la Terre. Cette vitesse est également connue sous le nom de vitesse de libération. La troisième vitesse cosmique (42,1 km/s), est définie comme étant la vitesse de libération d’un corps quittant le système solaire depuis l'orbite terrestre. Elle n'est d'aucune utilité dans notre cas.
Les 3 vitesses cosmiques
Intéressons nous à la deuxième vitesse cosmique, celle qui nous permettrait d'atteindre la planète rouge.
La vitesse de libération prend la valeur suivante, en mètres par seconde :
avec :
- G la constante gravitationnelle : G = 6,6742.10-11 N·m2·kg-2
- M la masse de l'astre, en kilogrammes
- R le rayon de l'astre, en mètres
- d la distance de l'objet à la surface de l'astre, en mètres
- μ le paramètre gravitationnel standard associé à la masse de l'astre : μ = GM
Pour quitter la Terre et partir en direction de Mars, il faut donner au vaisseau une impulsion pour qu’il puisse dépasser la deuxième vitesse cosmique. Mais il n'y a pas que le lanceur participe à l'impulsion initiale donnée à un vaisseau. Les engins spatiaux lancés à destination des autres planètes profitent surtout de la vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil et non de la vitesse fournie par le fonctionnement de leur moteur. Notre planète avance en effet sur son orbite à une vitesse d'environ 108 000 km/h.
Ariane V, le lanceur de satellite
La vitesse d'une sonde envoyée sur une orbite héliocentrique représente donc la somme vectorielle de la vitesse de la Terre autour du soleil (Vt, 29,8 km/s ou 108 000 km/h) et d'une partie de la vitesse (Vr) que le lanceur a communiqué à la sonde. La vitesse Vr est appelée vitesse résiduelle. Elle correspond à la différence entre la vitesse de libération et la vitesse fournie par le lanceur. Après avoir atteint les 11,2 km/s nécessaires pour échapper à l'attraction de la Terre, la vitesse restante est à la disposition de la sonde pour son voyage Terre - Mars.
La trajectoire que l'on donne au vaisseau spatial ne doit pointer directement la planète qu'à l'arrivée du vaisseau. Cette mobilité de la cible et la révolution des planètes autour du soleil explique les périodes déterminé dans le temps pour pouvoir lancer le vaisseau. Ces périodes sont appelées fenêtre de tir.
Uniquement les sondes lancées à l'intérieur d'une fenètre de tir ont une chance d'atteindre Mars. Mais la date de départ à l'intérieur d'une fenêtre à tout de même une certaine importance. Les orbites de la Terre et de Mars ne sont pas parfaitemnt circulaires et elles ne sont pas situées dans le même plan. Les fenêtres de tir n'étant pas identiques entres elles, certaines sont plus favorable que d'autre.
Un voyage classique dure environ 12 mois, pour réduire ce temps de trajet on pourrait utiliser la rotation de la Terre ou l'assistance gravitationnelle. Ce qui consiste à utiliser la rotation des autre planète en choisissant une trajectoire tel que la sonde s'approche de la planète sans l'heurter pour augmenter sa vitesse.
-1960 : Marsnik 1
Marsnik 2
-1962 : Spuntnik 22
Mars 1
Spuntnik 24
-1964 : Mariner 3 Programme Marsnik 1
Mariner 4
Zond 2
-1965 : Zond 3
-1969 : Mariner 6
Mariner 7
Mars 1969 A
Mars 1969 B
-1971 : Mariner 8
Kosmos 419
Mars 2
Mars 3
Mariner 9
-1973 : Mars 4
Mars 5
Mars 6 Sonde Mariner 9
Mars 7
-1975 : Viking 1
Viking 2
-1988 : Phobos 1
Phobos 2
-1992 : Mars Observer
-1996 : Mars Global Surveyor
Mars 96
Mars Pathfinder
-1998 : Nozomi
Mars Climate Orbiter
-1999 : Mars Polar Lander
Deep Space 2
Dispositif orbital de la mission Viking
-2001 : Mars Odyssey
Atterrisseur 01 (annulé)
-2003 : Mars Express
Beagle 2
Spirit
Opportunity
-2005 : Mars Reconnaissance Orbiter
-2007 : Phoenix
- 2011 : Phobos-Grunt
Yinghuo 1
Mars Science Laboratory
-2013 : Mars Orbiter Mission
MAVEN
-2016 : ExoMars Trace Gas Orbiter
ExoMars EDM
-2018 : InSight Vue d'artiste de la sonde spatiale MAVEN survolant Mars
Rover ExoMars
-2020 : Mars 2020
-2024 : Projet Mars One
Les sondes lancées vers la planète rouge depuis les débuts de la conquête spatiale ont en général tendance à ne jamais arriver. Sur 51 sondes spatiales, on compte seulement 19 succès, soit un taux de réussite de 37 % seulement.
En réalisant le décompte par pays, on s'aperçoit que les soviétiques sont les plus "malchanceux". Sur les 20 sondes lancées, seulement deux ont réussi à réunir quelques données.
Du côté américain, le taux de réussite est plus élevé, vu qu'environ 70% des sondes envoyées par la NASA ont réussies leur mission.
Voyons un peu d'ou proviennent ces nombreux échecs :
Explosion en vol, non séparation de la coiffe ... Ce type d'échec, appelé échec au lancement est certainement le plus frustrant. Avant même que la mission commence, tout est fini, et des années d'efforts sont réduites à néant en une fraction de secondes. Encore aujourd'hui, le lancement est un moment aussi excitant que redouté ...
- Marsnik 1 (1960)
- Marsnik 2 (1960)
- Mariner 3 (1964)
- Mars 1969 A (1969)
- Mars 1969 B (1969)
- Mariner 8 (1971)
- Yinghuo 1 (2011)
Explosion de la fusée Antarès,13 secondes après le décollage
Suite à un décollage réussi, la sonde se retrouve la plupart du temps orbite terrestre. Pour rejoindre Mars, elle doit s'extraire du champ de gravité de notre planète. Il suffit alors d'une défaillance d'un étage supérieur ou d'une mauvaise programmation pour que l'engin spatial se retrouve prisonnier de la Terre. Et après quelques révolutions, la sonde finit par retomber sur Terre.
- Spuntnik 22 (1962)
- Spuntnik 24 (1962)
- Kosmos 419 (1971)
- Mars 96 (1996)
- Phobos-Grunt (2011)
Les départs vers la planète Mars ne peuvent avoir lieu qu'à des moments bien précis (fenêtre de tir). Si cette période est dépassée, il faut patienter deux années supplémentaires.
- Zond 3 (1965)
Zond 3
Le voyage vers la planète rouge dure de nombreux mois, une durée suffisamment longue pour qu'un sinistre survienne. Une collision avec une météorite peut provoquer de sérieux dégâts et dévier la sonde de sa trajectoire.
- Mars 1 (1962)
- Zond 2 (1964)
- Pobos 1 (1988)
Avec le lancement, la mise en orbite constitue la phase la plus critique de la mission. Il faut que la sonde freine suffisamment pour adhérer au champ de gravité martien. Une mauvaise trajectoire, un freinage trop faible ou bien trop fort, c'est la catastrophe. L'engin rate la planète, ou rentre en collision avec elle.
- Mars 4 (1973)
- Mars Observer (1992)
- Mars Climate Orbit (1999)
L'atterissage. Lors de cette phase où s'enchaînent des évènements d'une incroyable complexité, l'erreur n'a pas le droit d'exister.
- Mars 2 atterrisseur (1971)
- Mars 6 (1973)
- Mars 7 (1973)
- Mars Polar Lander (1999)
- Deep Space 2 (1999)
La planète rouge peut également être la cause d'un échec avec les tempêtes de poussière. En recouvrant tout le globe d'un manteau opaque, une tempête peut ruiner la mission d'un orbiteur. La modification des paramètres atmosphériques peut aussi compromettre un aérofreinage.
- Mars 2 orbiteur (1971)
- Mars 3 orbiteur (1971)
Si la qualité de fabrication des systèmes de bords n'est pas bonne, la sonde risque d'être endommagée. Au mieux les instruments lâchent les uns après les autres, au pire on perd définitivement le contact.
- Mars 3 atterrisseur (1971)
- Mars 5 (1973)
- Phobos 2 (1988)
- Beagle 2 (2003)
Et puis il y a les missions réussies ...
- Mariner 4 (1964)
- Mariner 6 (1969)
- Mariner 7 (1969)
- Mariner 9 (1971)
- Viking 1 (1975)
- Viking 2 (1975)
- Mars Global Surveyor (1996)
- Mars Pathfinder (1996)
- Mars Odyssey (2001)
- Mars Express (2003)
- Spirit (2003)
- Opportunity (2003)
- Mars Reconnaissance Orbiter (2005)
- Phoenix (2007)
- Mars Science Laboratory (2011)
- Mars Orbiter Mission (2013)
- MAVEN (2013)
Mars Science Laboratory - Curiosity
Le projet Mars One : Mars One est un organisme à but non lucratif avec l’objectif d’établir un établissement humain sur Mars grâce à des technologies existantes. Mars One emmènera des humains sur Mars en 2025 pour fonder un habitat permanent à partir duquel nous pourrons prospérer, apprendre et nous développer. Avant que le premier équipage ne se pose, Mars One aura installé un habitat durable conçu pour recevoir de nouveaux astronautes tous les deux ans. Pour cela, Mars One a un projet précis et réaliste entièrement basé sur des technologies existantes. Mais les responsables du projet ne fournissent actuellement pas de détails crédibles sur la manière dont seraient résolues les contraintes techniques et financières qui ont jusqu'ici empêché la réalisation d'un projet de ce type. Actuellement ce projet paraît irréalisable du fait des nombreuses contraintes techniques, car aujourd'hui il n'existe pas de technique opérationnelle permettant de faire atterrir un vaisseau de plus d'une tonne sur Mars ou bien de systèmes de production de carburant et d'oxygène in situ (ISRU) qui ne sont pas au stade expérimental